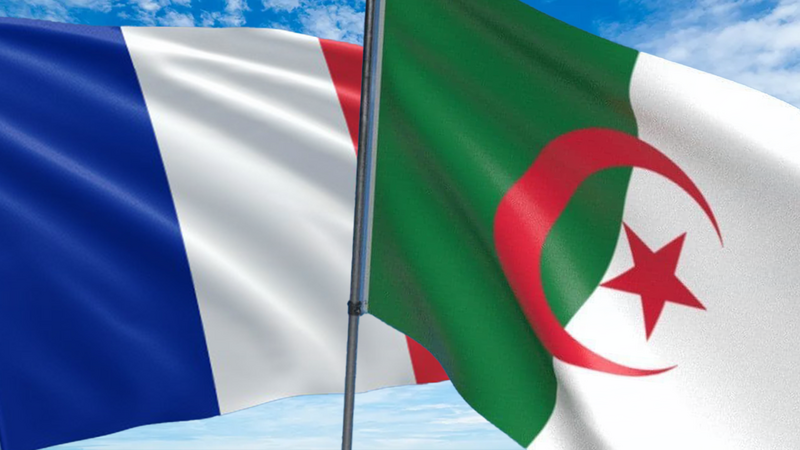
International
La crise entre la France et l’Algérie est alimentée par le régime algérien et ses réseaux qui œuvrent plus ou moins insidieusement à la déstabilisation de notre pays, révèle l’ancien ambassadeur de France à Alger, dans un essai édifiant France-Algérie, le double aveuglement dont Le Figaro publie les bonnes feuilles.
FigaroVox - 4 mai 2025 - Par Ronan Planchon
Aux sources de la crise
On ne comprend rien à la période qui commence si l’on ne retient pas que, dès 1962, le partenaire algérien de la France n’est pas celui que la France a choisi à Évian : c’est un régime de parti unique, avec le FLN à sa tête, régime dont l’armée est et restera la colonne vertébrale. Cette armée, l’Armée de libération nationale (ALN), estime avoir combattu pour l’indépendance, gagné seule la guerre contre la France et, dès le départ, et aujourd’hui encore, se considère comme le seul « propriétaire du pays » ; le peuple algérien n’est que le locataire et un simple usufruitier. Le propriétaire, dans cette vision de l’histoire, possède évidemment tous les droits. Comme le disent par dérision les Algériens eux-mêmes, « l’Algérie est le seul pays au monde qui ne possède pas une armée, mais où l’armée possède un pays »… Mais cela, dans sa « bienveillance », la France n’a pas voulu le voir.
Evidemment, la France n’a pas voulu intervenir dans les choix politiques internes de l’Algérie indépendante ; elle ne le voulait pas, trop heureuse d’avoir mis fin au conflit algérien ; elle ne le pouvait d’ailleurs pas, puisque le pouvoir était désormais transféré aux « nouvelles » autorités algériennes. Les confidences du général de Gaulle rapportées par Alain Peyrefitte montrent clairement un chef de l’État soucieux d’en finir au plus vite pour passer enfin à autre chose.
La relation qui s’instaure à partir de 1962 entre Paris et Alger est une relation fondée sur l’ambiguïté et nourrie de non-dits : d’un côté, une Algérie indépendante, confiée à un régime militaire qui pense ne rien devoir à l’ancien colonisateur, de l’autre une France un peu « honteuse » d’avoir fait la guerre, sept années durant, pour finalement perdre cette « perle de la couronne » coloniale qu’était l’Algérie et se voir obligée de rapatrier 1 million de pieds-noirs fuyant un pays qu’ils croyaient leur. Paris, au long des années suivantes, jouera le jeu de la coopération avec cette Algérie indépendante ; cependant, les règles du jeu ne seront pas celles qui ont été imaginées d’un commun accord à Évian.
Les réseaux algériens en France, une « cinquième colonne » ?
Le fait est qu’existent dans notre pays des « relais » identifiés et puissants, que le pouvoir algérien instrumentalise. Quand le président Tebboune, dans un discours d’avril 2024, dénonçait, sans rire, les réseaux français en Algérie, « véritable cinquième colonne », disait-il, sans doute avait-il en tête le modèle algérien sur notre territoire.
Le premier cercle, celui des réseaux officiels, est évidemment le réseau diplomatique et consulaire : une ambassade d’Algérie à Paris, dirigée de tout temps par un ambassadeur proche du pouvoir algérien. J’ai connu au moins quatre ambassadeurs, dont le sympathique Missoum Sbih lorsque j’étais son homologue à Alger, pendant huit ans. Il avait été directeur de l’ENA algérienne, professeur de Bouteflika, ambassadeur au Canada. Affable, très aimable, il était pour moi, comme pour le Quai d’Orsay, un interlocuteur de grande qualité. Suivirent des chefs de poste au profil plus rugueux, les ambassadeurs Bendjemaa (aujourd’hui, après une période de disgrâce, représentant permanent de l’Algérie à l’ONU), colosse qui ne cessait d’aboyer, et son successeur l’ambassadeur Mesdoua, particulièrement désagréable, qui n’hésitait pas à dénoncer mon travail auprès du ministre français des Affaires étrangères ; enfin Saïd Moussi, le dernier, très proche de Tebboune, qui a été successivement chargé d’affaires puis consul général d’Algérie à Paris. Dans cette galerie des portraits, l’ambassadeur Lebdioui (2019-2021), comme l’ambassadeur Sbih, essayaient de mettre de l’huile dans les rouages tout en défendant les positions algériennes.
Existe à l’ambassade d’Algérie un service chargé officiellement de la sécurité, dépendant du Département du renseignement et de la sécurité algérien (DRS) : vu la puissance de ce service sur le territoire algérien et son rôle dans la vie politique nationale, le représentant du DRS, tout-puissant, entretient des relations avec ses homologues français, mais surtout surveille les contacts et l’action des diplomates algériens, tout comme ceux des consulats et des mosquées. Le chef de ce bureau de l’ambassade est donc craint ; il court-circuite l’ambassadeur et ne répond qu’à ses supérieurs à Alger. Sid Ahmed Ghozali, ancien ambassadeur à Paris après avoir été premier ministre, au moment des premières élections libres en Algérie et jusqu’à l’assassinat du président Boudiaf, m’a raconté la toute-puissance du DRS dans ses deux expériences politiques. L’actuel patron des « services » algériens (services de renseignements) est aujourd’hui l’ancien responsable du DRS à Paris : après avoir dirigé l’antenne du DRS à l’ambassade d’Algérie à Berlin, où il avait montré son efficacité en organisant les soins prodigués au président Tebboune atteint du Covid-19 en 2020, ce dernier le bombarda à Paris. Récompensé par ce poste, il fut ensuite nommé à la tête des services de renseignements algériens, après avoir été promu général, en juillet 2024. (…)
Dans le quatrième cercle de ces réseaux figurent les multiples associations qui constituent autant de relais actifs de l’Algérie en France. On peut citer par exemple deux associations dont le rôle pro-algérien est évident. Il s’agit de l’Amitié franco-algérienne (AFA) et de l’Union française des binationaux et de la diaspora algérienne. Les deux associations ont été créées respectivement le 30 mai et le 14 juin 2023, soit, simple fruit du hasard sans doute, à quinze jours d’intervalle. Sur son site web, l’Union française des binationaux et de la diaspora algérienne évoque, à côté d’une image d’Ali la Pointe, sa mission de « préserver notre identité et de renforcer notre unité en tant que peuple algérien résidant en France ». Aucune information n’est communiquée sur l’identité du ou des dirigeants(s) de cette association, seule une adresse de siège social est communiquée et renvoie à l’annuaire des entreprises. Sur les réseaux sociaux, notamment X où elle possède un compte certifié suivi par plus de 26 000 abonnés, cette association relaie la propagande du régime algérien et va jusqu’à s’en prendre à des membres du gouvernement français.
Et si on revenait sur les accords d’Évian ?
L’immigration familiale algérienne représente plus de 60 % des premiers titres de séjour délivrés contre 40 % pour les ressortissants tunisiens et marocains. Les Algériens représentent donc le plus fort contingent de migrants qui viennent pour des raisons familiales et non professionnelles. Ils sont, selon l’Insee, la première nationalité étrangère en France. Le général de Gaulle se demandait d’ailleurs devant Alain Peyrefitte s’il ne convenait pas de modifier les accords d’Évian sur la question de la circulation des personnes. Près de soixante ans après sa signature, et même si le texte a été modifié depuis, l’accord franco-algérien de 1968 reste très avantageux pour les Algériens, qui bénéficient ainsi d’immenses privilèges dont ils savent jouer. Un changement majeur est certes intervenu en 1986, avec l’exigence, pour l’ensemble des pays étrangers, d’un visa en vue d’une entrée sur le territoire français. Cette obligation fut, par la suite, assouplie par la France ou supprimée pour les citoyens de nombreux pays étrangers, mais maintenue pour les États du Maghreb et certains autres pays considérés comme présentant un risque migratoire. Dès lors, l’obtention d’un visa est aujourd’hui la clé de la circulation et de l’installation d’un Algérien en France.
La note de la Fondapol sur l’accord franco-algérien de 1968 concluait à la nécessité, compte tenu du contexte lié à l’immigration en France, de mettre fin aux avantages dont bénéficient encore aujourd’hui les ressortissants algériens. Ces avantages sont évidemment la raison pour laquelle le gouvernement algérien est tant attaché à ce texte et l’a fait savoir : il ne veut pas que ses ressortissants entrent dans le droit commun, il veut montrer son statut supérieur à celui des voisins marocains, il sait enfin que les failles de l’accord de 1968 permettent à une partie non négligeable de la population de s’installer subrepticement chez l’ancien colonisateur. Quelle revanche de l’histoire ! (…)
Pour ma part, après avoir tourné le problème dans tous les sens, j’en suis arrivé à la conclusion que la dénonciation, la remise en cause de l’accord de 1968, malgré ses révisions successives, constituait la seule solution. (..)
Comment procéder ? L’accord ne prévoit en effet pas de clause de dénonciation, ce qui fait dire à certains qu’on ne peut rien faire. C’est donc, par hypothèse, l’article 56 de la convention de Vienne sur le droit des traités qui s’appliquerait. Cet article a codifié le droit international coutumier et prévoit une « dénonciation unilatérale s’il est établi qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une dénonciation ou si le droit de dénonciation peut être déduit de la nature du traité ». Il peut être soutenu que l’accord de 1968 n’a pas vocation à être perpétuel, comme peut l’être par exemple un traité de paix, et que l’immigration est bien un sujet qui peut évoluer dans le temps, les circonstances de 2025 étant différentes de celles de 1968. Enfin, l’article 12 de l’accord prévoit la mise en place d’une commission mixte pour « examiner les difficultés qui viendraient à surgir ». On peut imaginer que c’est en se référant à cette commission mixte que le premier ministre a décidé d’ouvrir une « renégociation » dans un délai de six semaines.
En outre, la dénonciation de l’accord de 1968 ne devrait pas avoir pour effet de rétablir les dispositions antérieures des accords d’Évian, plus favorables, ayant le même objet, celles-ci pouvant être considérées comme ayant été implicitement abrogées par l’accord en question. Tactiquement, nous pourrions en fait demander une renégociation « sérieuse » de l’accord de 1968, négociation assortie d’un délai, au terme duquel, si rien n’aboutit, la dénonciation s’ensuivrait.
L’heure est venue de « tourner la page »
Sur le court terme, malheureusement, et, je le crains, jusqu’en 2027, les choses ne s’arrangeront pas : il est probable, vu l’état d’esprit des autorités d’Alger, que la crise perdurera, avec le risque d’une escalade, voire d’une rupture des relations diplomatiques. Au-delà, nous devrions définir nos objectifs, les conditions de cette refondation, notre méthode et nos moyens.
L’objectif de cette nouvelle politique à l’égard d’Alger devrait être, me semble-t-il, de normaliser la relation. Normaliser, c’est-à-dire passer d’une relation qui s’est voulue exceptionnelle (le fameux « partenariat d’exception ») à une relation normale, ce qui ne veut pas forcément dire banale. Cette relation normale n’a en fait jamais existé depuis 1962. J’en ai expliqué les raisons, largement historiques et parfois « morales », qui nous ont amenés à regarder le partenaire algérien comme un objet de remords. Nous pourrions quasiment dire avec Victor Hugo, à propos de l’Algérie : « Et il (l’algérien) était dans la tombe et regardait Caïn. » Nous n’avons jamais réussi à chasser ce sentiment de culpabilité, ces remords qui nous poursuivent. Aujourd’hui, en 2025, il est temps, selon la formule du général de Gaulle, de « tourner la page » et de passer à autre chose.
Pour atteindre cet objectif, il faut remplir deux conditions. La première est de parvenir à séparer les aspects de politique intérieure et ceux de politique étrangère. C’est ce mélange des genres qui nous a empêchés d’être lucides depuis 1962. De fait, nous devrions ne traiter l’Algérie qu’à travers la politique étrangère, cesser de considérer qu’elle fait partie de notre politique intérieure ; avoir sur elle un regard objectif, clinique, moins passionné ; parvenir à traiter l’Algérie comme nous traitons l’Allemagne, l’Australie ou l’Argentine… avec probablement un petit quelque chose en plus malgré tout. Alger, je l’ai montré, profite de cette confusion des genres, et sait parfaitement jouer de l’aspect « intérieur » de la « question algérienne ». La seconde condition est de distinguer les Algériens de l’Algérie, distinguer le peuple et le « système ». (…)
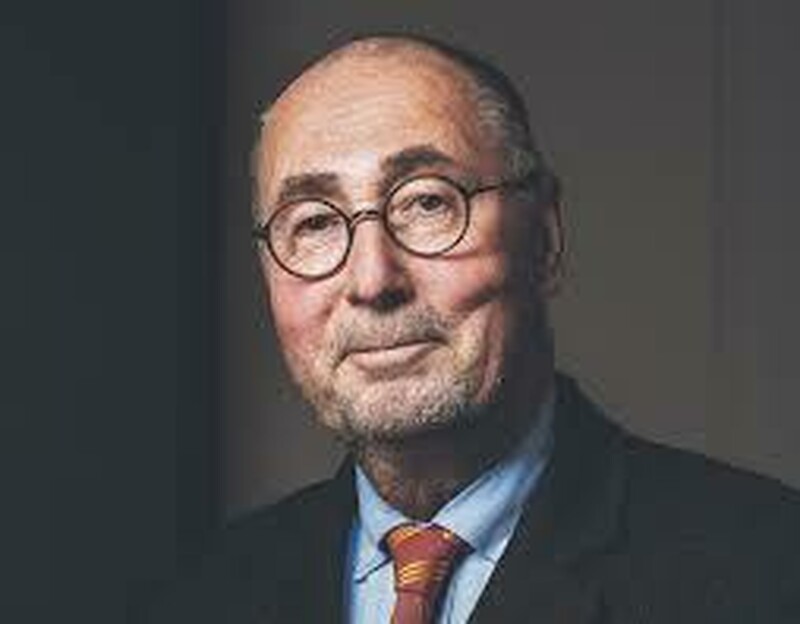
Réflexion faite, nous n’avons pas gagné grand-chose dans ce partenariat exclusif avec l’Algérie officielle, celle du pouvoir : ni véritable coopération sur les grands dossiers, ni parts de marché supplémentaires, ni aide des consulats algériens sur les questions migratoires, ni solutions aux multiples difficultés quotidiennes que rencontrent les Français d’Algérie, ni contreparties en échange des nombreux visas que la France délivre, ni sans doute, ajouterais-je, l’estime du pays et de ses dirigeants. Qu’avons-nous donc gagné à délivrer des titres de séjour à de nombreux VIP algériens sans compensations, sauf à être humiliés et à nous faire claquer la porte au nez ? Nous croyons encore trop aujourd’hui qu’Alger, sensible à nos sourires et à nos paroles aimables, nous aidera et nous « renverra l’ascenseur », alors que son objectif véritable, on le voit clairement dans la crise actuelle, est d’humilier l’ancien colonisateur et son président. Il faut donc parvenir à cette double séparation mentale chez nos hommes politiques, séparation entre la politique étrangère et la politique intérieure, distinction entre le « système » et le peuple algériens. C’est une véritable révolution culturelle que nous devons faire. Nous devons aussi la faire pour les très nombreux Algériens qui vivent paisiblement en France.
- Hits: 619

